 Silvia Federici est une universitaire italienne enseignant aux États-Unis. Wikipedia la rattache au mouvement féministe autonome (en gros : anarchiste et d’extrême gauche). Moi, je l’aurai rangé dans les féministes matérialistes. Elle s’autodéfinit « féministe marxiste », même si elle règle des comptes avec Marx. Mais on ne va pas se battre sur les terminologies.
Silvia Federici est une universitaire italienne enseignant aux États-Unis. Wikipedia la rattache au mouvement féministe autonome (en gros : anarchiste et d’extrême gauche). Moi, je l’aurai rangé dans les féministes matérialistes. Elle s’autodéfinit « féministe marxiste », même si elle règle des comptes avec Marx. Mais on ne va pas se battre sur les terminologies.
Son livre le plus célèbre est « Caliban et la sorcière ». Mais c’est une grosse somme. J’ai commencé par une dose plus petite avec « Le Capitalisme patriarcal ». Ça a fait partie de mes lectures post-confinement. Comment construire un monde d’après différent, si tous les porte-parole de ce monde d’après (et en particulier ceux qui parlent de l’effondrement) ont tous des hommes universitaires blancs ? Pour reprendre la magnifique phrase d’autre Lorde : « On ne détruira pas la maison du Maître avec les outils du Maître ». Si on ajoutait dans la critique du capitalisme une critique féministe ?
Pourtant, aujourd’hui, tout le monde à gauche intègre « patriarcat » à la liste des dominations à éradiquer. Mais juste en passant. Même Damasio, après avoir pratiqué la SF sexiste, parle d’abattre le patriarcat quand il parle du monde d’après. C’est choupi. Mais le sexiste n’est pas une conséquence du capitalisme (ça fait longtemps que les féministes matérialistes l’ont signalé). Serions-nous en train de nous repasser les mêmes plats ? La lutte des classes d’abord, les femmes après ? Et si le patriarcat était imbriqué dans le capitalisme, l’un nourrissant l’autre, comme une association de malfaiteurs ? C’est l’argument de Federici.
 Le capitalisme patriarcal est une suite d’articles traitant des liens entre le travail reproductif gratuit des femmes, le travail en usine et l’accumulation de richesses (en taillant des croupières à Marx en passant). C’est une lecture qui demande une certaine concentration, pas vraiment du livre de plage… mais au bout d’un moment, comme tous les articles sont sur le même thème, on finit par rentrer dans la pensée de l’autrice.
Le capitalisme patriarcal est une suite d’articles traitant des liens entre le travail reproductif gratuit des femmes, le travail en usine et l’accumulation de richesses (en taillant des croupières à Marx en passant). C’est une lecture qui demande une certaine concentration, pas vraiment du livre de plage… mais au bout d’un moment, comme tous les articles sont sur le même thème, on finit par rentrer dans la pensée de l’autrice.
Sa critique de Marx est à la fois simple et fondamentale : pour Marx, le centre du processus de production est le suivant : le travailleur gagne un salaire et avec ce salaire, il satisfait ses besoins vitaux par l’achat de nourriture, de vêtements, etc. « Marx ne reconnait jamais qu’il faut du travail, le travail de reproduction, pour cuisiner, nettoyer, pour procréer » p. 13, comme si le travailleur se reproduisait tout seul, sans effort et sans travail (de soin, d’éducation, et sexuel). Or, il y a deux processus indissociables : le processus de production (de marchandises) et le processus de reproduction (de la force de travail). Le premier est majoritairement masculin et salarié. Le second est féminin et gratuit.
A l’époque de Marx, peu de travail reproductif se passait effectivement dans la famille prolétaire. Hommes et femmes travaillaient de l’aube au coucher du soleil. Les femmes ayant un salaire, en général misérable, se prostituaient pour compléter leur revenu. Les rapports gouvernementaux officiels reviennent fréquemment sur les risques de l’extinction de classe ouvrière : les femmes refusaient (ou n’avaient pas matériellement la possibilité) de se consacrer (gratuitement) à la reproduction de l’ouvrier. Les femmes mariées « rentrent au foyer fatiguées et lasses et refusent de faire le moindre effort supplémentaire pour rendre la maison confortable. […] si bien que lorsque le mari rentre, il trouve tout inconfortable, la maison sale, aucun repas préparé, les enfants pénibles et chamailleurs, l’épouse irritée et négligée et son foyer si désagréable que bien souvent il se rend au pub et devient ivrogne ». Sans compter que les filles des usines n’avaient aucune compétence ménagère : ne savaient pas coudre, cuisiner et avait tendance à utiliser leur paye pour satisfaire leur besoin, menaçant la morale bourgeoise avec leurs habitudes masculines : comme fumer et boire dans les bars.

A la fin du XIXe, des lois sur la santé au travail limite le travail des femmes drastiquement, simultanément, le salaire des hommes augmente de 40% : « En ce sens, on peut lire la naissance de la ménagère à temps plein […] comme une tentative de restitution aux travailleurs salariés hommes des communs qu’ils avaient perdus avec l’avènement du capitalisme sous la forme d’un vaste réservoir de travail non payé effectué par les femmes » p.83.
Certes, l’espérance de vie des travailleurs qui étaient d’environ 30 ans fait un bon. Mais à la sortie de la Première Guerre mondiale, « les femmes avaient entamé une trajectoire qui les privait de leur indépendance à l’égard des hommes et les séparait toujours davantage les unes des autres, les contraignant à travailler dans l’espace clos isolé du foyer, sans disposer d’argent à elles et sans compter leurs heures de travail » p.142.
Federici emploie la formule « travail sexuel » pour l’inclure dans le travail reproductif. « Travail sexuel » est une formule employée en général par les régulationnistes pour parler de la prostitution. Pour le dire vite, le mouvement féministe est fortement scindé en deux catégories : les abolitionnistes qui sont contre la prostitution et la pénalisation des clients, et les régulationistes qui sont pour une règlementation de la prostitution au profit des prostituées. Quelle est la position de Federici dans ce clivage ? Je ne dirais qu’elle ne prend pas clairement position sur la situation actuelle (même si elle semble pencher vers un régulationisme très encadré), mais explique en tout cas pourquoi le sexe a bien été conçu par le capitalisme, mais également par Marx (sans le reconnaître) comme un travail reproductif (quoi qu’il puisse être par ailleurs).
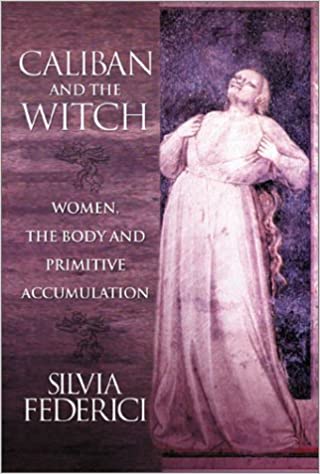 Le sexe a longtemps été le seul plaisir des pauvres, plaisir nécessaire, puisqu’on attend de la classe ouvrière qu’elle se reproduise en abondance. Or, au moment où l’industrie anglaise et américaine de la fin du XIXe a besoin de travailleurs compétents et vigoureux, les ouvrières estiment qu’elles ont mieux à faire que des tâches ménagères ou des enfants, puisque leur paye leur permet de faire des choix autonomes, qu’elles soient ou non mariées. C’est alors que la vertu, l’abnégation totale pour son foyer, la maternité glorifiée… toutes ces choses réservées préalablement aux bourgeoises sont demandées également aux femmes du peuple. L’ouvrier digne est celui qui gagne assez pour que sa femme reste à la maison (tiens, ça me rappelle une célèbre citation de David Douillet…). L’amour conjugal et l’instinct maternel sont omniprésents dans les discours des réformateurs du travail en usine : transformer l’ouvrière – prostituée occasionnelle (mais payée dans les 2 cas), en mère au foyer dévouée, sacrifiant ses intérêts et fournissant un service ménager et sexuel au travailleur qui voit sa condition s’améliorer puisqu’il bénéficie gratuitement de ce travail. Le mariage a alors signifié pour les femmes prolétaires « être des domestiques le jour et des putains la nuit » p.154, puisque si elles voulaient abandonner une de ces 2 tâches, elles tombaient dans la pauvreté, et dans les conditions misérables dans lesquelles les prostituées étaient maintenues, via le contrôle étatique de la prostitution.
Le sexe a longtemps été le seul plaisir des pauvres, plaisir nécessaire, puisqu’on attend de la classe ouvrière qu’elle se reproduise en abondance. Or, au moment où l’industrie anglaise et américaine de la fin du XIXe a besoin de travailleurs compétents et vigoureux, les ouvrières estiment qu’elles ont mieux à faire que des tâches ménagères ou des enfants, puisque leur paye leur permet de faire des choix autonomes, qu’elles soient ou non mariées. C’est alors que la vertu, l’abnégation totale pour son foyer, la maternité glorifiée… toutes ces choses réservées préalablement aux bourgeoises sont demandées également aux femmes du peuple. L’ouvrier digne est celui qui gagne assez pour que sa femme reste à la maison (tiens, ça me rappelle une célèbre citation de David Douillet…). L’amour conjugal et l’instinct maternel sont omniprésents dans les discours des réformateurs du travail en usine : transformer l’ouvrière – prostituée occasionnelle (mais payée dans les 2 cas), en mère au foyer dévouée, sacrifiant ses intérêts et fournissant un service ménager et sexuel au travailleur qui voit sa condition s’améliorer puisqu’il bénéficie gratuitement de ce travail. Le mariage a alors signifié pour les femmes prolétaires « être des domestiques le jour et des putains la nuit » p.154, puisque si elles voulaient abandonner une de ces 2 tâches, elles tombaient dans la pauvreté, et dans les conditions misérables dans lesquelles les prostituées étaient maintenues, via le contrôle étatique de la prostitution.
Le bordel était finalement le travail sexuel rationalisé, efficace, facile, le travailleur n’a pas à séduire, à négocier, il vient consommer du sexe. Les bordels ont été jugés par l’état capitaliste nécessaire au bien-être du travailleur. Leurs femmes étaient supposées être incapables de les satisfaire sexuellement, puisqu’elles pratiquaient un sexe vertueux et reproductif (donc sans plaisir, puisqu’elles étaient des femmes « bien »).
Mais il faut reconnaître que le sexe rationalisé et planifié (en famille ou au bordel) était bien dans les fantasmes des marxistes. « Qu’elle se part de bannière étoilée ou de faucille et de marteau, il y a toujours au coeur du capital la glorification de la vie familiale » p.120. Or, la famille elle-même (et en particulier les femmes et les enfants) résiste à la planification. Savourez donc ce passage du « camarade Gramsci », comme elle l’appelle : « Tous ces éléments compliquent et rendent très difficile toute règlementation du fait sexuel et toute tentative de créer une nouvelle éthique sexuelle conforme aux méthodes de production et de travail […] La vérité est que le nouveau type d’homme que réclame la rationalisation de la production et du travail ne peut se développer tant que l’instinct sexuel n’a pas été réglementé […] et lui aussi rationalisé » p.121. Au moins, quand le train déraille, il s’arrête. Les hommes marxistes de la première heure ? Jamais ! L’usine et sa production rationnelle sont le modèle de toute la société.

Terminons cette recension par un thème peu abordé dans ce livre-ci, mais très important par ailleurs : le fait que pour Marx, les humains se réalisent par leur travail et qu’une des mesures de cette réalisation est la capacité à dominer la nature (idée commune avec le capitalisme). Or le travail est décrit comme masculin et la nature comme féminine. Et je me permets un parallèle avec une composante importante de la masculinité hégémonique : avec un pouvoir sur les objets et les éléments: cette vision du travail et de l’activité participe fortement à la masculinité hégémonique ce qui amène à la proposition suivante : « Les écoféministes ont montré qu’il y avait un lien profond entre le rejet du travail ménager, la dévalorisation de la nature et l’idéalisation de ce qui est produit par l’industrie et la technologie humaine » p.59.
Federici a évidemment été critiqué par de pures marxistes, et pourtant, elle n’est pas si dure avec Marx. Elle cherche à comprendre comment cet esprit brillant a pu passer à côté du sexisme et du racisme comme système d’exploitation indépendant et imbriqué dans le capitalisme. Mais le fond de l’affaire, ce n’est pas tant que Marx se centrait sur autre chose ou n’a vu que le début de l’industrialisation, c’est plutôt que tout attentif qu’il fût aux rapports de domination, il n’était pas plus éclairé sur la question des femmes que la majorité de ses contemporains : cette domination-là était pour lui naturelle.
