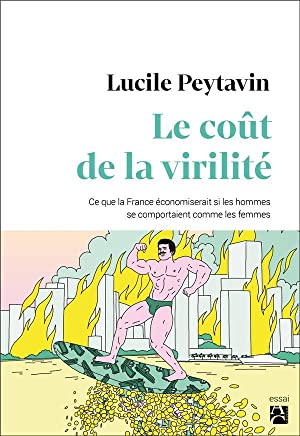 Lucile Peytavin : Le coût de la virilité
Lucile Peytavin : Le coût de la virilité
Edition Anne Carrière, 2021
Lucile Peytavin est historienne de l’histoire des femmes. C’est indirectement, en travaillant sur sa thèse, qu’elle réalise que la plupart des comportements asociaux sont le fait des hommes : 84% des auteurs des accidents de la route mortels, 92% des élèves sanctionnés pour actes relevant d’atteintes aux biens et aux personnes au collège (en général : aux biens, ne vous affolez pas !), 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mis en cause pour meurtre et 97% des auteurs de violences sexuelles.
En conséquence, elle pose une question assez astucieuse : ça coûte combien, tout ça ? Pas tant en termes de vie, de bien-être, de temps, non, en termes d’argent. Ces comportements des hommes coûtent combien à la société ?
La question n’est pas si neuve. Je dis souvent à mes étudiant-es en guise de boutade qu’il est peu prudent d’accepter que le sexe représenté à 96% en prison soit aussi nombreux à l’Assemblée et au Sénat. En faisant le parallèle avec les arguments qui ont longtemps justifié l’éviction des femmes, je propose de réfléchir à l’inéligibilité des hommes, en tant que groupe statistiquement irrespectueux des règles de la république. Évidemment, je n’en pense pas un mot, mais ça permet de reconsidérer la puissance (et la toxicité) des arguments naturalistes.
Lucile Peytavin mène son raisonnement au bout. Elle va réellement compter combien ça coûte, certes avec une grosse louche, mais les sommes sont tellement importantes qu’on accepte une marge d’erreur.
Prenons par exemple les incendies de forêts: 90% des incendies de forêts sont déclenchés par des humains et 99% de ces humains sont des hommes.
- Coût des interventions pour incendies volontaires : 0,25 milliard d’euros
- Coût des interventions pour incendies volontaires déclenchés par des hommes : 0,2 milliard d’euros.
Et il en va ainsi pour différents postes budgétaires : violence hooligan, aide aux victimes d’agression, coût pénitentiaire, conduite à risque amenant une surmortalité, etc.
Ce coût, c’est, selon Peytavin, le coût de la virilité et non le coût des hommes. Si les hommes n’étaient pas élevés pour être virils, s’ils étaient élevés comme des femmes, c’est-à-dire à la compassion, tournés vers le souci de l’autre, vers la collaboration et non la domination, on fera des économies tellement colossales qu’on pourrait réinvestir cet argent pour le bien commun. Séduisant pas vrai ?

Pour justifier qu’il s’agit bien d’un coût de la virilité et non du fait biologique d’être homme, Peytavin utilise plusieurs chapitres à reprendre des recherches sur la vision commune de la nature (la fiction du mâle alpha chez les animaux ou l’image erronée des « hommes des cavernes » et le sexe du cerveau) puis explique la construction sociale des identités sexuées et des inégalités qui en découlent. Assez classique comme partie, mais c’est un essai « tout public » : cette dénaturalisation est nécessaire et plutôt bien faite.
Arrivée vers la fin du livre, cette thèse du coût portée par la virilité en tant « qu’ennemi principal », aussi séduisante que provocatrice, laisse un peu insatisfaite. Elle présente deux renversements de situation qui me semblent un peu rapides, en termes d’analyse.
Tout d’abord, mes collègues et moi-même avons suffisamment critiqué la vision erronée qui présente les femmes comme le problème et donc les hommes comme la solution. De manière générale, on considère que les femmes s’orientent mal, ne savent pas négocier leur salaire, établir un réseau, prendre la parole en public, s’imposer, etc. Il s’agit donc de les aligner sur les comportements des hommes (enfin, sur ceux qui ont réussi). Autrement dit : Fix the Women alors que la solution durable et efficace est plutôt Fix the System.
Peytavin prend bien acte qu’il s’agit d’une construction sociale de la virilité, mais ne la replace pas dans le système de genre. En somme, quand elle dit qu’il faut élever les hommes comme les femmes, elle dit : Fix the Men. Les hommes sont le problème et les femmes la solution. Si je doute que ça fonctionne dans un sens, je n’y crois pas plus dans l’autre sens.
L’autre problème, c’est qu’elle me rappelle les marxistes de la Grande époque, quand ils nous disaient que le capital et la propriété privée étaient l’inégalité première, que les autres inégalités en découlaient (les hommes possédaient les femmes et les esclaves, la propriété privée seraient donc antérieurs au sexisme et au racisme). Donc si on abolit la propriété privée et l’exploitation du travail d’autrui, les autres inégalités sociales disparaîtront. Séduisant aussi, mais ne résistant pas à l’analyse historique, anthropologie et social. Par exemple, les Baruyas de Nouvelle-Guinée ne connaissent pas la propriété privée, mais sont très oppressifs envers les femmes.
Chez Peytavin, le principe est renversé. La cause première n’est pas la propriété privée, mais la virilité et le reste (les inégalités de classe) en découle (elle ne traite pas tellement les inégalités ethnoraciales).
Or les rapports sociaux (sexe, classe et d’ethnicité) s’entrecroisent pour former quelque chose qui est plus que la somme des rapports sociaux, plus compliquée. Des phénomènes qui font que des femmes blanches ont pu posséder en leur nom propre (pas à celui de leur mari) des femmes et hommes esclaves noirs aux États-Unis par exemple.
Bref, parler de l’intersectionnalité des rapports sociaux, c’est justement prendre acte qu’il n’y a pas une cause première, mais une consubstantialité et une co-construction des rapports sociaux d’où découlent les systèmes de domination.
Donc en somme, c’est malin de chiffrer le coût de la virilité. C’est intéressant de rappeler qu’elle est tout aussi construite que la féminité… et pour le reste, je vous conseille la lecture de la sociologie intersectionnelle.
