 Des filles chez les garçons. L’apprentissage de la mixité par Geneviève Pezeu
Des filles chez les garçons. L’apprentissage de la mixité par Geneviève Pezeu
Éditions Vendémiaire 2020
L’école moderne est mixte. Il est même remarquable de constater à quelle vitesse la non-mixité qui a prévalu si longtemps est aussi vite devenue démodée. À quelques exceptions près, la mixité est devenue la norme et la non-mixité renvoie soit à une école du passé, soit à une école confessionnelle. Ce qui était une promiscuité immorale au début du XXe siècle est devenu au contraire le gage d’une socialisation saine et bénéfique 50 ans plus tard. Comment un tel tour de passe-passe s’est-il produit ? Et surtout, comment s’est-il produit en douceur, pratiquement sans qu’on se rende compte du glissement ? C’est ce que nous raconte Geneviève Pezeu, en faisant l’histoire de l’arrivée des filles chez les garçons jusqu’au décret Haby promulguée en 1976 qui rend la mixité obligatoire dans les ordres d’enseignement… prenant finalement acte d’une situation de fait.
Au début, il y avait la séparation des sexes à l’école… et aussi la séparation des classes sociales. Surtout la séparation des classes sociales. Pour les pauvres, la séparation des sexes était secondaire d’ailleurs. D’une part parce qu’ils et elles étaient vu-es comme une masse indistincte et, d’autre part, parce que les élèves pauvres quittaient l’école à la puberté.
Quand on va commencer à parler à la fin du XIXe siècle d’une éducation secondaire pour les jeunes filles (comme pour les jeunes garçons d’ailleurs), c’est pour les filles de la petite et moyenne bourgeoisie ; la grande bourgeoisie étant tout à fait satisfaite des l’instruction catholique ou des cours privés.
Ce qui est remarquable, c’est que dès le départ, ce qui agite les hommes de l’époque, ce n’est pas de savoir si les filles auront le niveau pour suivre un enseignement secondaire, mais d’être certain que l’on pourra maintenir la division sexuée des savoirs et du travail en instruisant les filles.
Prenons par exemple l’anatomiste Paul Broca, plus doué avec les cerveaux dans le formol qu’avec ceux qui se situent encore dans la tête des gens. Broca est certes convaincu de l’infériorité intellectuelle des femmes (ainsi que des ouvriers et des noirs), mais estime qu’elles « seraient capables sans doute de suivre jusqu’au bout et avec succès le programme des lycées » p.36. Mais ce n’est pas de ça qu’on parle. Les groupes dominants ont toujours pris soin de faire un tri dans les savoirs : de quoi les femmes ont-elles besoin pour être des mères de famille ? Pas des langues mortes (celles qui permettent de passer le bac et d’entrer à l’université), pas de philo (ce qui leur permettrait de réfléchir et d’acquérir un esprit critique), mais de la morale, de l’arithmétique (faut faire les comptes du ménage), des disciplines artistiques et de la littérature (ça permet des discussions mondaines)… et le tout, pas trop longtemps. C’était déjà le projet de Fénelon (mais au XVIIe, c’était un précurseur), de Rousseau (déjà nettement moins brillant au moment des Lumières) et finalement le projet de la IIIe République.
Néanmoins des écoles primaires supérieures voient le jour partout en France et dans la foulée, des écoles normales distinctes pour former des femmes et des hommes au professorat. Évidemment on ne parle pas de mixité : les femmes sont supposées enseigner aux filles et les hommes aux garçons… sauf que dans le concret, on ne peut pas maintenir la séparation des sexes partout : puisqu’il faut des écoles dans chaque village, on n’a pas toujours les moyens (humains et financiers) d’avoir 2 écoles. De manière pratique et économique, l’institutrice s’occupe des petits et l’instituteur (souvent son mari) des grands. Toutefois, cet arrangement des sexes ne s’appelle pas la mixité : surtout, on ne mélange pas ! C’est la gémination : les filles et les garçons sont dans la même classe, mais tout est fait pour qu’ils et elles se croisent le moins possible, surtout chez les plus grand-es : un paravent ou un muret les séparent en classe, la récréation se fait par groupe de sexe, etc. Les moeurs sont sauves : « on confie les plus petits à une mère », p.44. C’est dire si l’ordre est respecté.
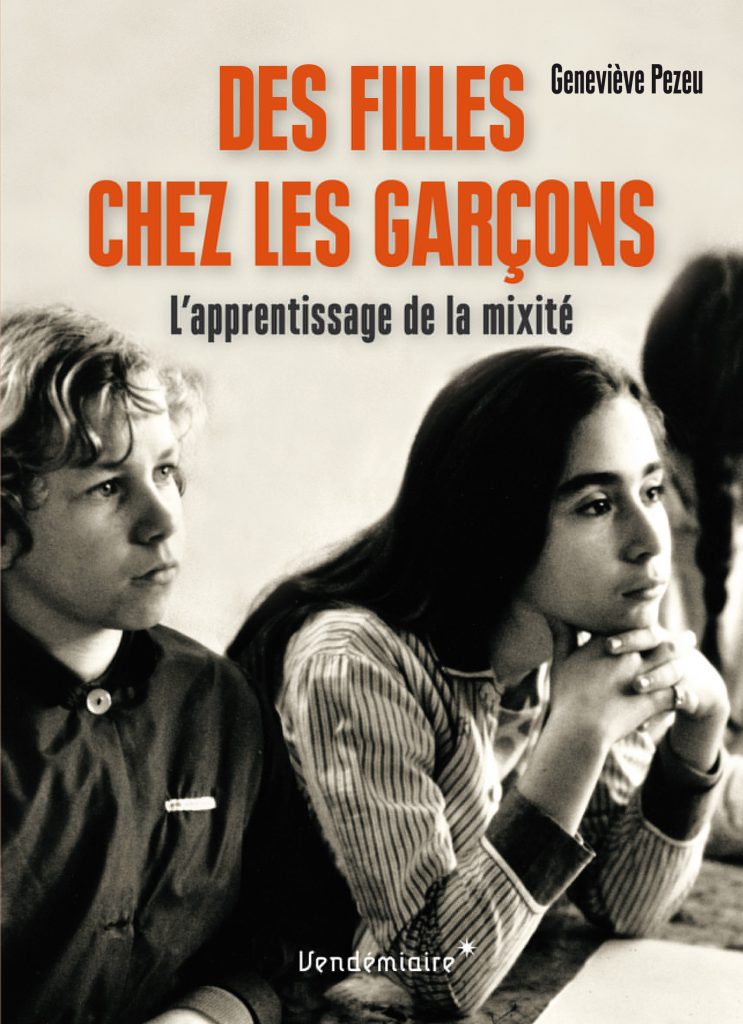
Après la Première Guerre mondiale, les choses se compliquent. Avant la guerre, il y a eu un réel effort pour construire des établissements secondaires féminins. Mais après guerre, il faut prioriser les dépenses. D’autant plus que les jeunes filles n’ont plus l’air de vouloir se contenter de l’enseignement féminin, celui qui leur bloque l’accès aux études supérieures et à certains concours. Elles peuvent maintenant passer le bac en candidates libres, mais pour cela, elles doivent savoir le latin, qu’on n’enseigne pas dans leurs écoles secondaires. Soit elles sont les moyens d’avoir des cours particuliers… soit elles obtiennent des dérogations pour aller au lycée de garçons. S’en suit toute une littérature de pères, d’enseignants ou même de principaux de lycées qui écrivent au Ministre pour demander à ce que les filles puissent s’inscrire avec les garçons. D’autant plus que les questions de mobilités limitent l’accès des filles aux études : les parents sont hésitants à laisser leur fille étudier loin (ça ne change pas) et n’en ont pas toujours les moyens.
Les dérogations sont de plus en plus acceptées, parfois parce que le lycée de garçons manque d’effectifs (après guerre, on a un « trou » dans les générations), parfois aussi parce que les demandeurs (pères et enseignants) ne lâchent pas l’affaire et veulent le meilleur avenir pour ces filles. Ces filles sont souvent d’ailleurs des garçons manquants: sans frère ou avec un frère moins compétent qu’elles, leur père reporte sur elles leurs attentes professionnelles. Par ailleurs, la guerre larvée contre l’école dite libre, c’est à dire catholique est toujours présente : si la République n’instruit pas ses filles, l’école catholique sera enchantée de le faire…
Une espèce de mixité clandestine s’installe et se passe sans heurt. Les filles restent très minoritaires parmi les garçons, mais comme elles sont sursélectionnées, ce sont d’excellentes élèves. Tout est fait pour qu’elles ne croisent jamais les garçons. En effet, même les pédagogues les plus convaincu-es par la coéducation (comme on l’appelle à l’époque) restent méfiant-es quant au risque du mélange des corps. Les filles sont saluées pour leur sérieux et leur influence bénéfique (civilisatrice) auprès des garçons… Cela n’a pas changé. Le fait qu’elles soient souvent meilleures que les garçons ennuient un peu… on le met sur le compte non pas de l’intelligence, mais d’une maturité plus précoce, cela non plus n’a pas changé. Pour le reste, il s’agit de faire attention à ce que toute sensualité, tout érotisme soit banni… On leur met des uniformes peu élégants exprès et soyons clair : on ne laissera passer aucun crop-top… ah non, ça, c’est pour la rentrée prochaine. Finalement, beaucoup de choses n’ont pas changé…

Et puis la 2e guerre mondiale se passe. Au sortir de cette guerre, une forme d’égalité des sexes apparait dans la loi : « La loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes » p.143. Sauf pour ouvrir un compte bancaire. Sauf pour travailler. Sauf pour choisir le domicile conjugal. Sauf… bref, vous avez compris, il y aura encore un peu de travail. Quoiqu’il en soit, les femmes votent et il faut donc les former comme les hommes à être des citoyennes. C’est la fin de l’enseignement féminin et le début des lycées expérimentaux. On a toujours des angoisses morales autour du mélange des sexes, mais on s’achemine tout doucement vers les années 60 et une libération des moeurs. La mixité qui s’est installée dans de nombreux endroits n’est pas remise en cause, on discute plutôt de comment il convient de surveiller les deux sexes dans ce contexte. Quand la loi Haby passe, après mai 68, on est dans un autre univers scolaire et il ne s’agit plus de faire (officiellement) la police des moeurs.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Nicole Mosconi, Claude Lelièvre, Claude Zaidman, Michèle Zancarini-Fournel et toute leur descendance académique ont suffisamment écrit que la mixité était la condition nécessaire, mais non suffisante de l’égalité. La question des bonnes moeurs est toujours tapie : quand Nicolas Sarkosy autorise de nouveau l’existence de classes non mixtes, c’est pour faire plaisir aux lycées catholiques privés sous contrat. Il s’agit toujours d’apprendre aux garçons à devenir des hommes et aux filles à devenir des femmes, même si je me demande à quel endroit du programme cette mission est spécifiée.
Outre-Atlantique, des courants font la promotion de la non-mixité au prétexte que l’école est devenue féminine et féminisante, et donc serait responsable de l’échec scolaire des garçons. Il est tout de même amusant de noter que dès le début, quand les filles sont allées à l’école des garçons, elles ont été meilleures qu’eux. Ne serait-ce pas plutôt le système de genre qui leur enseigne qu’étudier et suivre les règles sont des activités mettant en danger leur virilité qui en est la cause ?
La mixité reste en tout cas régulièrement attaquée : elle est aussi accusée de desservir les filles, utilisées comme assistantes pédagogiques pour civiliser les garçons, menacées par des stéréotypes en leur défaveur en sciences, et maintenues au silence par des garçons qui occupent ⅔ de l’espace sonore. Quand on me demande si la mixité est un obstacle à l’égalité à l’école, je réponds : « je ne sais pas, on l’a jamais essayé ».
La mixité au secondaire, c’est en réalité une juxtaposition des sexes. Comme l’a dit un génial chef d’établissement : « la mixité, c’est comme la vinaigrette, dès qu’on arrête de mélanger, ça se sépare » p.209. Je dis à mes étudiant-es, futur-es enseignant-es au secondaire que je vais leur faire un cours de mixité. Elles et ils sont surpris. Quand je leur demande quels sont les arguments en faveur de la mixité… elles et ils sont peu bavard-es. Une fois qu’on a parlé du vivre-ensemble… on a apparemment tout dit. C’est pour ça que je fais des cours de mixité : pour leur apprendre à mélanger la vinaigrette de sorte que la mixité puisse devenir un moyen d’apprendre dans un contexte égalitaire d’une manière égalitaire.
