 Clémence Perronet (2021). La bosse des maths n’existe pas. Rétablir l’égalité des chances dans les matières scientifiques, Éditions Autrement.
Clémence Perronet (2021). La bosse des maths n’existe pas. Rétablir l’égalité des chances dans les matières scientifiques, Éditions Autrement.
Clémence Perronnet a soutenu son doctorat avec Christine Détrez et est maîtresse de conférence à l’Université catholique de l’Ouest. Je connais bien son travail, j’ai été dans son jury de thèse et quand je la lis, je me sens comme chez moi avec les références théoriques : Nicole Mosconi, Françoise Vouillot, Gaël Pasquier, Christine Détrez évidemment, et moi-même.
La couverture présente un sympathique dessin où tout le monde fait de la science par Marion Montaigne (Profe Moustache : Tu mourras moins bête).
Le livre s’ouvre ensuite sur un dialogue entre Clémence Perronnet et Marion Montaigne où elles parlent de leur rapport à la science et ses stéréotypes. Une anecdote m’a fait sourire. Les deux autrices racontent que les personnes qui les voient en vrai s’étonnent de leur apparence. Marion Montaigne a beau dessiner Profe Moustache, elle ne lui ressemble pas. Clémence Perronnet a beau être féministe, elle n’en « a pas l’air » !! Ça m’a rappelé quand, il y a une quinzaine d’années, je suis allée donner une conférence à des intervenantes scolaires. J’avais beau faire signe aux organisatrices, elles ne m’identifiaient pas. Il a fallu que je me lève, que je présente et que je signale que j’étais la conférencière suivante. J’ai eu droit à un regard de la tête au pied : jupe aux genoux, bottes et ongles bleus… Dissonance cognitive manifeste : je ne ressemblais pas à une conférencière féministe.

Quel constat ?
Le livre commence par un constat : même si la France collectionne les médailles Fields (pays le plus doté avec les États-Unis), elle est en queue de peloton quand il s’agit des compétences mathématiques des élèves en général. L’école française sait fabriquer de l’excellence, mais au prix d’un décrochage de la majorité des autres élèves. Et pourtant, la France a besoin de former des scientifiques. Il y a quelques années, le thème de la crise de la vocation scientifique était même à la mode… on allait manquer d’ingénieur… La cause de cette désaffection était soi-disant une perte de confiance dans une science « bonne » qui rendrait le monde meilleur. Cette pure invention politique ou journaliste n’a jamais été validée par la moindre enquête chez les jeunes. Les enfants ont aimé et aiment toujours la science. De fait, cette crise n’a jamais eu lieu et les carrières scientifiques attirent toujours autant. En revanche, elles n’attirent pas une population très variée : en majorité, les cohortes de scientifiques sont constituées par la population dominante de leur pays, donc en France, ce sont des hommes blancs issus de classes moyennes ou favorisées. En 2013, 41% des élèves des classes favorisées étaient en sciences, contre 10% des élèves des classes populaires (p.43).
Du côté de la répartition femmes – hommes, l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail dans les années 80 a eu des répercussions dans les écoles d’ingénieurs sous la forme d’une « révolution respectueuse » (Marry, 2004), mais depuis 15 ans, la part des femmes suit une asymptote qui plafonne aux abords de 30%[1].
Les sciences, plus égalitaires ?
 Clémence Perronnet rappelle que ces écarts ne sont évidemment pas causés par des cerveaux rose ou bleu, ou par des performances moindres de la part des filles : avant la réforme de bac, les filles avaient plus de mentions « bien » et « très bien » au bac S que les garçons.
Clémence Perronnet rappelle que ces écarts ne sont évidemment pas causés par des cerveaux rose ou bleu, ou par des performances moindres de la part des filles : avant la réforme de bac, les filles avaient plus de mentions « bien » et « très bien » au bac S que les garçons.
Serait-ce une question de goût ? Outre le fait qu’on peut se demander comment se forment nos gouts, on ne constate pas de différence d’intérêt chez les filles et les garçons avant l’adolescence. De même, il n’y a pas de différence selon la classe sociale… là encore, jusqu’au secondaire : les jeunes sont nombreux à aimer les sciences et à se projeter dans un métier scientifique.
Avec une certaine logique, les maths et les sciences ont longtemps été vues par les fondateurs de l’école républicaine comme les disciplines les plus aptes à réaliser l’égalité des chances. Elles sont moins dépendantes d’une culture classique attachée aux Humanités qui restent l’apanage des classes favorisées (p.38). En outre, les mathématiques (et en partie les sciences) utilisant un langage formel, il était aisé de croire que tout le monde avait les mêmes chances devant ce langage qui ne véhiculait pas de contenus culturels sexistes ou ne nécessitant pas un capital littéraire familiale.
Rétrospectivement, on y voit bien où le raisonnement de l’école républicaine a pêché : s’il est plus facile d’apprendre des déclinaisons latines avec une famille capable de nous faire réviser le latin, il est également plus facile d’apprendre les identités remarquables avec une famille connaissant l’algèbre. Par ailleurs, en sciences de l’éducation, nous savons bien qu’apprendre à l’école, ce n’est évidemment pas uniquement ingurgiter des contenus. C’est aussi être disposé-e à apprendre des contenus qui font sens, avec un but que l’on comprend, dans un environnement sécure qui nous respecte et qui nous reconnait… bref, on ne se débarrasse pas d’une socialisation primaire et secondaire sexiste et classiste uniquement en passant au langage formel !
L’enquête
Clémence Perronnet a enquêté dans un quartier très populaire. Elle a rencontré des jeunes (23 filles et 30 garçons) à 9 ans, en CM1 et de nouveau à 12 ans, en 5e, pour parler de leur famille, de leurs expériences scolaires et de leur pratique et perception des sciences. Reprenons rapidement la théorie du capital de Bourdieu : les pauvres ne se distinguent pas uniquement par leur capital économique moindre (revenus et patrimoine), mais aussi par un plus faible capital social (les relations) et capital culturel (ce que l’on sait ainsi que les objets culturels que l’on possède). Ce sont les différentes facettes de ce capital culturel que Clémence Perronnet va étudier dans sa population autour de ces deux questions : est-ce que les sciences sont pour moi ? Est-ce que j’ai envie d’en faire mon métier ?
Dans l’échantillon, le premier constat est clair : un tiers des élèves n’a aucune pratique scientifique, 30% en ont rarement, essentiellement via des émissions comme : « C’est pas sorcier » ou « On n’est pas des cobayes ». Néanmoins, au cours des entretiens, le difficile quotidien de nombreuses familles s’impose à la chercheuse et nous rappelle que la culture est un luxe inaccessible, financièrement et en termes de temps à lui consacrer.
Par ailleurs, comme le rappelle Clémence Perronnet via A. Lareau, les parents de classes populaires ne considèrent pas que l’organisation des loisirs soit un aspect central de leur rôle de parents. Les parents des classes moyennes pratiquent « l’acculturation concertée » (en suggérant des activités jugées bonnes et éducatives) alors que les familles populaires sont davantage dans la « réalisation du développement naturel », le but étant que les enfants sachent se débrouiller seuls, sur la base de leurs capacités innées. Au contact de l’école, une hiérarchie s’établit vite entre ces deux stratégies : les premiers parents sont jugés investis dans l’éducation de leur enfant. Les autres perdent en légitimité.
Littéraire ou scientifique ?
En ce qui concerne les savoirs scolaires, la croyance en une scission ferme entre littéraire et scientifique est solide. Chez les parents qui ont été les premiers membres de leur famille à finir une scolarité secondaire, les Humanités classiques sont valorisées. Ils se sont approprié la culture des dominants (ce que Perronnet appelle la culture « conquise à transmettre » p.99) sans réaliser que les dominants sont déjà passés à autre chose. Il me semble que dans les représentations communes, la culture littéraire est supposée être la base que tout le monde peut avoir (même les classes populaires si elles travaillent dur – il « suffirait » d’apprendre par cœur l’orthographe, de lire des livres…), alors que le génie s’exprime dans les sciences.
À partir de là, Clémence Perronnet va nous proposer des portraits passionnants de plusieurs élèves qu’elle a rencontrés : Rahmatta qui veut s’en sortir grâce aux sciences, Naïma qui arrive à faire une combo « princesse scientifique », Rama qui ose aimer les sciences et Salim qui en décroche parce qu’il n’est pas assez bon élève… Malheureusement, pour lui comme pour Bilal, les sciences et la pratique scientifique sont liées à l’école : rejeter le monde scolaire, s’y sentir illégitime amène à rejeter les sciences.
Peut-on devenir scientifique quand on vient de REP+ ?
Les filles semblent partir avec un avantage : meilleures élèves que les garçons, avec la volonté de progresser grâce à l’école… on s’attend à ce que l’école entretienne chez elles le gout des sciences. Mais dans le cas, ce sont les stéréotypes qui vont les détourner : à la fois ceux produits par le système de genre, mais aussi celui qui porte sur les classes populaires ou les élèves issu-es de la migration. Notons que contrairement aux idées reçues, la religion n’est pas un obstacle pour apprendre les sciences, les élèves savent très bien faire la part des choses. De même, les classes populaires n’ont pas plus de stéréotypes de sexe que les classes favorisées. Néanmoins ils et elles ont de bonnes raisons de croire dans des compétences innées pour les filles et les garçons : puisque l’école et la société ne cessent de promouvoir l’égalité des sexes, les différences qui continuent à s’exprimer… sont à l’évidence une émanation de la nature. Sans connaissance sur le genre et la domination masculine et devant la ségrégation horizontale et verticale des métiers et des compétences, il est contre intuitif de penser que les savoirs sont construits.
Dans le même temps, l’effet pygmalion (qui amène les élèves à devenir comme l’enseignant-e les voit) tourne à plein : on le voit dans les avis des enseignant-es entre le CM2 et la 6e, ou dans les jugements pétris de bonnes intentions des animateur-trices culturel-les.
Finalement, ces élèves de classe populaire, malgré un gout initial pour les sciences, ne vont pas pouvoir en faire.
Voici le mécanisme que Clémence Perronnet met au jour, issu d’une analyse vraiment brillante et vraiment intersectionnelle (ce qui est rare) :
« Pour être scientifique, il faut être très intelligent. Une fille pourrait devenir scientifique puisque dans ma classe, elles sont les meilleures élèves. Cependant pour être scientifique, il faut aussi être un homme » donc les filles ne s’y intéresseront pas (p. 188-189). Le même raisonnement est appliqué aux garçons, qui ont l’avantage d’être des hommes, mais ne sont pas assez bons élèves.
Et là, c’est peut-être mon seul point de questionnement par rapport au travail de Clémence Perronnet : est-ce qu’être bon élève, c’est être intelligent ? J’ai le sentiment que si être bonne élève ne suffit pas pour les filles, c’est aussi que chez elles, la réussite scolaire n’est pas vue comme de l’intelligence et pour faire des sciences, il faut avant tout être intelligent.
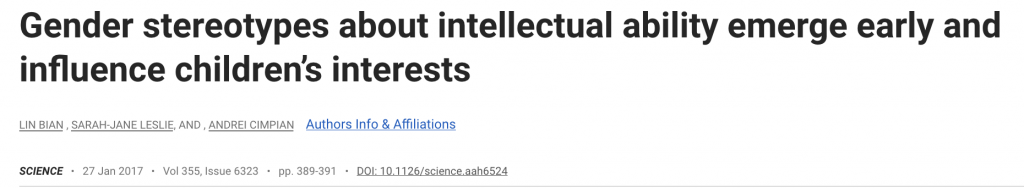
Cette idée me vient d’une étude qui porte sur 400 enfants. On raconte aux enfants une histoire sur une personne « vraiment très intelligente », sans leur dire son sexe. Les enfants devaient ensuite dire s’il s’agissait selon eux d’un homme ou d’une femme. À 5 ans, garçons et filles attribuaient à parts égales leur propre sexe comme étant celui du personnage « très intelligent ». Dès 6 ans, en revanche, les filles étaient moins nombreuses à faire ce choix que les garçons. Idem quand il s’agit de choisir un jeu destiné à des enfants très très intelligents (vs un jeu qui demande des efforts) : les filles se désintéressent du jeu présenté comme nécessitant l’intelligence. En revanche, filles et garçons indiquent l’enfant qui a les meilleurs résultats scolaires est probablement une fille.
L’intelligence semble se situer au-delà des résultats scolaires, elle appartient aux garçons (probablement davantage aux garçons des classes favorisées), mais ils l’ont, indépendamment de leurs résultats.
Cette question se combine avec une autre portant sur la classe sociale et les représentations des enseignant-tes (et le sexe). Chez les enseignant-es, un garçon de milieu favorisé peut être très intelligent, mais peu scolaire (s’il ne travaille pas, c’est parce que l’école ne lui convient pas, dira-t-on… dans un certain nombre de cas, on va même le diagnostiquer HPI, haut potentiel). En revanche, un garçon des classes populaires n’est pas ascolaire : il est nul. Les filles sont rarement perçues comme acolaire (et plus rarement HPI d’ailleurs). Puisqu’elles sont tenues de faire de leur mieux, quand elles échouent, c’est qu’elles sont peu intelligentes. Et quand elles réussissent, c’est qu’elles sont travailleuses.
Solutions ?
Évidemment, les constats de Clémence Perronnet sont assez décourageants, en particulier quand elle montre que les dispositifs de sensibilisation aux sciences dans les quartiers ne marchent pas vraiment… disons que s’ils marchent, ils ne parviennent pas à renverser la tendance. C’est bien à l’école qu’il faut agir continuellement, mais pas seulement en déconstruisant les stéréotypes, comme si ceux-ci n’étaient fabriqués par personne et agissaient tels des « processus zombies » (Collet, 2021). Il faut exposer le système de genre, former les enseignant-es et (là, c’est mon grain de sel), pratiquer une pédagogie de l’égalité.
Bref, la recherche de Clémence Perronnet est vraiment éclairante et son livre se lit de manière très fluide, car il est très clair.
———-
[1] La récente réforme du bac a aggravé les choses. Les élèves ont désormais 3 options en première et doivent en abandonner une en terminale. La longue censure sociale qui pèse sur les filles depuis leur naissance a eu raison de la confiance en soi d’un certain nombre d’entre elles : pensant jouer la sécurité, elles abandonnent les maths en Terminale, se fermant ainsi la porte des CPGE et écoles d’ingénieurs.

