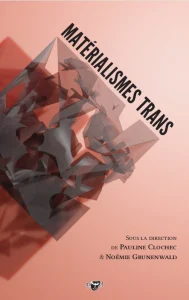 Ma précédente Kro date de janvier et celle-ci va intéresser deux personnes et demie. Mais j’ai travaillé dur pour l’écrire. Alors tant mieux pour ces 2 personnes et demie, si ça leur sert. A la fin ya un clin d’oeil au Seigneur des anneaux. C’est juste du racolage pour tenter de faire scroller 10 personnes…
Ma précédente Kro date de janvier et celle-ci va intéresser deux personnes et demie. Mais j’ai travaillé dur pour l’écrire. Alors tant mieux pour ces 2 personnes et demie, si ça leur sert. A la fin ya un clin d’oeil au Seigneur des anneaux. C’est juste du racolage pour tenter de faire scroller 10 personnes…
Matérialisme trans sous la direction de Pauline Clochec & Noémie Grunenwald, avec les contributions de Philippa Arpin, Séverine Batteux, Emmanuel Beaubatie, Eli Bromley, Pauline Clochec, Joao Gabriel, Noémie Grunenwald, Constance Lefebvre & Karl Ponthieux Stern.
Voilà un titre de prime abord surprenant et qui rend la chercheuse matérialiste que je suis à la fois curieuse et modeste, car, de prime abord, j’aurai dit que ce titre était un oxymore. Jusqu’à présent, je pensais qu’il y avait deux univers distincts : celui de la sociologie (ou de la philosophie) matérialiste qui s’intéresse aux rapports de production ou de reproduction (pour aller vite) et celui de la psychologie qui s’intéresse notamment aux questions d’identité, au sein duquel figure les questions trans.
Les sociologues matérialistes se sont assez peu préoccupé·es des questions de sexualité, sauf quand il s’agissait de parler de contrainte sexuelle exercée par le patriarcat. L’exercice d’une sexualité, quelle qu’elle soit semblait relever d’un choix ou d’une disposition individuelle. Iels se sont également peu préoccupé·es des questions trans, puisque ce sujet semblait relever exclusivement des mouvements queers et de la psychologie. Bref, les questions LGBTIQ*, c’était de l’ordre de l’intime et pas du rapport social.
C’est pourquoi je ne m’en suis pas spécialement préoccupée pendant longtemps en travaillant sur l’orientation scolaire et professionnelle, les attitudes des enseignant·es, l’imaginaire genré de l’informatique, etc. Mais au même titre que la question des sexualités sont devenues inévitables à l’école, par le seul fait qu’il y a dans la société des individu·es qui adoptent des comportements non exclusivement hétérosexuels, les questions trans sont devenues tout aussi inévitables.
Mais en parallèle, un autre problème est apparu : des étudiant·es se montraient à ce point fasciné·es par les questions d’identité sexuelle ou de transidentité qu’iels en venaient à considérer que les études sur les filles et les garçons étaient caduques et que le simple fait de parler de filles et de garçons était transphobe. Or, si je veux bien admettre que je préjuge de l’auto-identification des élèves en parlant de filles et de garçons, il ne suffit pas de dire que l’assignation de sexe est une construction sociale pour annihiler le patriarcat, c’est-à-dire l’expérience matérielle effective d’une domination du groupe des hommes sur le groupe des femmes. Sachant évidemment qu’en parlant des groupes des hommes ou des femmes, je ne qualifie pas les identités sexuelles / sexuées de chacun des membres de ces groupes, mais je parle de classes de sexe, qui hiérarchisent puis labellisent les individu·es identifié·es comme appartenant à ces groupes, sans leur demander leur avis.
Enfin, j’étais navrée par l’agressivité qui jaillissait autour de ces questions chez certains membres des mouvements militants trans comme chez les certains groupes féministes dites tradfem ou TERF, vous imposant de prêter une allégeance inconditionnelle à l’une ou l’autre des factions, de sorte qu’il devenait risqué de discuter, si on ne s’était pas assuré d’être en bonne compagnie. Les personnes qui ont été simultanément accusées de transphobie et d’être le jouet du délire trans me comprendront.
Bref, s’il y a bien un livre qui semble pouvoir dépasser ce conflit aussi réducteur qu’exaspérant, ça me semblait être Matérialisme trans.
 Ce livre m’a conquis dès l’intro… même avant, dès l’« avertissement aux lectrices et aux lecteurs, aux lecteur-rices, au lectorat ou à l’audience (au choix) » parce que c’est une façon de dire qu’on est à la fois dans l’expérimentation, dans l’invention et dans la transgression. Toute position dogmatique est déplacée, y compris par la suite dans la manière de dégenrer ou démasculiniser le texte. Un livre qui introduit la question trans avec de l’humour ne peut qu’être de bonne compagnie… Et je note que la notation avec x (comme lecteur-x-trice, ou étudiant-x-es) n’est jamais utilisée, alors qu’elle tend à apparaître de plus en plus dans les copies de mes étudiant·es, y compris quand iels font l’économie de toute réflexion sur les rapports hiérarchiques en pensant qu’une écriture ultra inclusive permet d’économiser la réflexion. C’est comme ces recherches qui collectent la variable sexe et ensuite, n’en font rien.
Ce livre m’a conquis dès l’intro… même avant, dès l’« avertissement aux lectrices et aux lecteurs, aux lecteur-rices, au lectorat ou à l’audience (au choix) » parce que c’est une façon de dire qu’on est à la fois dans l’expérimentation, dans l’invention et dans la transgression. Toute position dogmatique est déplacée, y compris par la suite dans la manière de dégenrer ou démasculiniser le texte. Un livre qui introduit la question trans avec de l’humour ne peut qu’être de bonne compagnie… Et je note que la notation avec x (comme lecteur-x-trice, ou étudiant-x-es) n’est jamais utilisée, alors qu’elle tend à apparaître de plus en plus dans les copies de mes étudiant·es, y compris quand iels font l’économie de toute réflexion sur les rapports hiérarchiques en pensant qu’une écriture ultra inclusive permet d’économiser la réflexion. C’est comme ces recherches qui collectent la variable sexe et ensuite, n’en font rien.
Tout d’abord, ne pensez pas que ce livre va vous expliquer l’origine du désir de transition, ni ce qui fait que des gens transitionnent et d’autre pas. Il est vrai qu’il pourrait être intellectuellement satisfaisant de connaitre la source, mais ça ne change rien à l’existence des faits. Souvenez-vous : on travaille sur la domination masculine / le patriarcat / le genre sans vraiment se préoccuper de la cause première. Il n’y a donc pas de raison de demander aux chercheur·es de ce collectif de justifier l’origine de leur objet.
Le programme de ce collectif est le suivant : « Refusant la réduction des réalités trans à des questions d’identité, cet ouvrage assume une perspective féministe matérialiste : il s’agit d’aborder les conditions sociales des personnes trans, leurs positions dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, ainsi que leurs inscriptions dans les mouvements féministes. » La perspective matérialiste est effectivement limpide. Et alors, qu’est-ce que ça donne ? Et surtout : est-ce que la formule « rapports sociaux de sexe » va pouvoir parler de la question trans ? Je connais des militant·es féministes qui s’évanouiraient à moins : utiliser « sexe » est devenu aussi violent pour elles et eux qu’utiliser « nègre » : ce serait le révélateur d’une pensée essentialiste.
Le premier chapitre de Pauline Clochec fait une généalogie de la pensée matérialiste, depuis son origine marxiste à la possibilité d’un matérialisme trans, en passant par le féminisme matérialiste. Que signifie « matériel » dans ce cas ? Il s’agit de ramener l’histoire à ses supports concrets : les rapports sociaux et les intérêts économiques des classes sociales, et non à des représentations ou des idées abstraites comme le droit ou la justice. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’étudier l’existence sociale et historique des humains à partir de leur conscience, mais à partir des conditions matérielles de leur existence et des pratiques qui en découlent, notamment le travail. Les individus forment une classe, à partir du moment où ils s’opposent à une autre classe. La classe qui a été tout d’abord étudiée est la classe sociale (au point qu’on se contente de parler de « classe » sans plus de précision). Le féministe matérialiste, théorisé par Delphy, se concentre sur la classe de sexe. Il pose en préambule un principe antinaturaliste : le genre précède le sexe, c’est-à-dire que c’est le système social qui préside à la hiérarchie des sexes (i.e. le genre) qui produit deux groupes humains supposés homogènes (les hommes et les femmes) qu’on va ensuite prétendre naturel, pour justifier à rebours la hiérarchie.
Je me permets de marquer une pause : je sais qu’il existe dans la nature des mâles et des femelles, ce n’est pas de cela dont on parle ici. La division femmes / hommes attribue bien d’autres caractéristiques que simplement des appareils reproducteurs différents. Quand on voit le nombre de fois où, dans une vie, ces appareils reproducteurs sont utilisés, on est en droit de s’étonner que ce soit devenu une caractéristique à ce point central pour définir les individus.
Reprenons le texte de Clochec. On en arrive à la notion de classe de sexe, il s’agit de rendre compte de l’oppression des femmes à partir de leur position dans les rapports de production. À cela, Nicole-Claude Mathieu ajoute l’autre grand vecteur de l’oppression que sont la sexualité et la reproduction. Gardons à l’esprit que le but du matérialisme, c’est d’abolir le genre, c’est-à-dire d’abolir l’Ennemi principal (pour citer Delphy), le système hiérarchique. En langue matérialiste, on dira que l’abolition du genre permettra d’abolir les rôles de sexe. Est-ce qu’on peut appeler ce système hiérarchique le patriarcat ? Pas d’après Guillaumin et surtout pas d’après Wittig qui estime que le terme Patriarcat renaturalise les sexes en supposant des rôles de pères et de mères : l’hétérosexualité apparait donc comme le régime politique fondamental dans la constitution hiérarchique des classes de sexe.
Second aparté : à mon sens, arrivé·es à ce stade de la réflexion, nous constatons que les rapports sociaux de classes sociales et de classes de sexe (pour employer une terminologie complète) ne vont pas permettre de penser l’oppression spécifique qui pèse sur les individu·es non exclusivement hétérosexuel·les. Il ne s’agit pas ici de discuter de la manière dont une conscience (on pourrait dire une identité) homo ou hétéro se constitue, mais bien comment l’appartenance à ces groupes sociaux hétéro / non-hétéro produit des conditions matérielles inégales pour les individu·es. Comme le propose Gaël Pasquier, nous pourrions parler de rapports sociaux de sexualités (encore que le terme sexualités incluant les pratiques, je me dis que les pratiques sexuelles ne définissent pas de rapports sociaux).
Après toutes ces considérations, Clochec nous amène vers un matérialisme de la transitude (on pourra lire aussi du fait trans) et non de la transidentité. L’approche féministe matérialiste de la transitude se démarque des théories queers qui mettent souvent de côté l’oppression du féminin au nom d’une utopie queer dégenrée. Elles mettent au centre une subversion individuelle (néolibérale ?) et éventuellement artistique des codes sexués. Chez Butler, par exemple, la transidentité serait une donnée intérieure, une identité de genre. Le fait trans n’est politiquement pertinent que comme un processus social. Ainsi, le programme du matérialisme trans est donc d’appréhender la transitude « non à partir d’un état psychique, mais d’un processus observable, à savoir la transition, et de comprendre celle-ci comme un processus social comportant des aspects pouvant être relationnels, juridiques et corporels » p.41.
Ce qui est important de comprendre, dans ce processus, c’est que si la transition est certes une question d’identité de genre (cette fois, je suis dans le chapitre d’Emmanuel Beaubatie), c’est avant tout une question de mobilité sociale. Les trans ne sont normatifs ou subversifs ni par essence ni par hasard, ce sont des transfuges de classe de sexes, et le sens de la mobilité change considérablement leur expérience de transition.
Sans surprise, cet ouvrage taille des croupières au féminisme « queer », accusé de fétichiser les femmes trans. D’après Constance Lefèbvre, p.110 : « pour ces mouvements qui considèrent que la subversion des normes de genre est le moyen privilégié de subvertir le genre, d’abolir les catégories homme/femme et la hiérarchie associée, les personnes trans, censées incarner une forme de subversion du genre, sont au centre des discours », mais à certaines conditions. La bonne façon d’être trans, pour le féminisme queer, c’est la désidentification : « se revendiquer femme n’est pas aussi bien toléré pour les femmes trans que pour les femmes cis. Dans certains cas, elles sont même découragées dans leurs démarches de transition : modifier son corps au travers d’opérations, en particulier d’opérations génitales, est interprété comme une tentative de normalisation du corps « déviant » des femmes trans. » p.111. En somme, le féminisme queer instrumentalise les femmes trans au service d’une utopie dégenrée. Comme ajoute Lefèbvre : le corps des femmes trans devient un enjeu idéologique, comme l’est le corps des femmes, en général.
On en vient alors inévitablement à la place des femmes trans dans les mouvements féministes en général et cet ouvrage propose une base de discussion ni fumeuse, ni naturalisante : « les femmes trans doivent être incluses dans le féminisme non pas du fait d’une notion abstraite d’identité de genre, ou parce que la structure de notre cerveau ferait de nous des femmes, mais parce que nous partageons des expériences matérielles et des buts avec les autres femmes. Les femmes en tant que classe partagent l’expérience d’être modelées comme des personnes qui sont exploitées, soumises et opprimées par les intérêts et la domination des hommes en tant que classe » p.46. J’ai déjà entendu une kyrielle d’objections à cette phrase d’Alysson Escalante (que d’autres chapitres de l’ouvrage s’attacheront à démonter), mais elle a le mérite de poser les éléments du débat dans un contexte matérialiste clairement défini.
Je vous laisse découvrir dans le détail les autres articles, sur la place des hommes trans, les corps trans racisés, etc. Et je termine sur le seul point qui me laisse sur ma faim. Ce n’est pas « trans » le mot qui revient massivement dans les écoles, mais plutôt « non binaire ». Cette appellation fourre-tout recouvre de très nombreuses revendications : on peut y trouver un ras-le-bol des assignations stéréotypées, un malaise à devoir choisir dans un système qui flèche deux possibles : fille-proie ou garçon-prédateur, une rébellion adolescente contre un corps mystérieux qui se transforme et bien sûr, une affirmation trans. Comment qualifier alors cet ensemble qui ne relève souvent pas de la transitude, mais qui doit être pris au sérieux : il ne s’agit ni de mode, ni d’un caprice ado, ni d’un grand plan de subversion des mouvements trans et/ou féministes. Beaubatie effleure le sujet, mais de manière insatisfaisante : « Une division centrale oppose des personnes dites « binaires » à d’autres qui se disent « non-binaires ». Les premier-ère-s s’identifieraient en tant qu’hommes ou femmes, acceptant de s’inscrire dans un modèle dimorphique, tandis que les secondes souhaiteraient s’en extraire. » On notera alors qu’en toute logique, on peut considérer comme binaire les personnes trans. Il ajoute : « Les façons qu’ont les individus d’habiter le genre ne sont ni dichotomiques ni monolithiques. Si l’espace social de classe a été amplement investigué par les sciences sociales, il n’en a pas été de même pour l’espace social du genre. Or, nombreuses sont les positions qui coexistent au sein de cet espace. » J’adhère volontiers à cette formule d’espace social du genre qui va permettre de regrouper dans une seule formule toutes les questions qui découlent du genre, sans les réduire à l’une ou l’autre dimension. Plutôt que de partir dans une énumération infinie de rapports sociaux de sexe, de sexualités, de genre (quoi que ça puisse vouloir dire), je suis tentée de parler à partir de maintenant de rapports sociaux dans l’espace du genre (un rapport social pour les gouverner tous, un rapport social pour les trouver, un un rapport social pour les amener tous et dans les ténèbres les lier… oups pardon, j’étais restée sérieuse trop longtemps, mais si vous êtes arrivée à la fin du texte, vous avez bien mérité cette citation probablement apocryphe de Tolkien).
